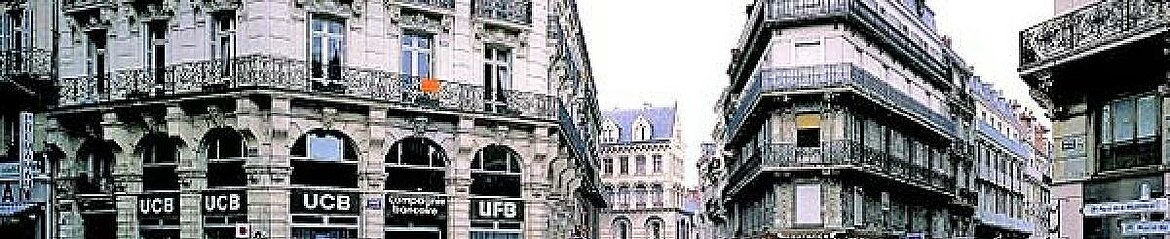L'habitat au XIXème siècle
La tradition néo-classique
Les premières demeures bien identifiées datent des années 1830/1840 : il s'agit d'hôtels particuliers de style néo-classique finissant ou néo-Renaissance inscrits dans la continuité urbanistique forte des boulevards-promenades créés à l'emplacement des fortifications. Quelques architectes, Alexandre Richard-Delalande, Sébastien Dellestre notamment, se sont fait une spécialité de ces demeures à deux, trois ou quatre logis derrière une façade commune sur la rue, tels les 3-7, Ouvre une nouvelle fenêtre ou 37bis bd du Roi-René, Ouvre une nouvelle fenêtre.
Certains hôtels restent cependant fidèles au parti aristocratique de la cour antérieure comme l'hôtel de Puisard, 4 rue du Quinconce, Ouvre une nouvelle fenêtre (1837) : un édifice d'esprit palladien par son plan massé et ses baies en triplé au centre de la façade, dû à Edouard Moll, architecte des hôpitaux d'Angers et de Sainte-Gemmes.
L'éclectisme des styles
Les deux dispositions subsistent sous le Second Empire et les débuts de la IIIe République : l'hôtel Montrieux, 3 bd du Maréchal-Foch, Ouvre une nouvelle fenêtre, de l'architecte parisien Mortier (1861) ou le grand hôtel jumelé Lafarge dû à Alexandre Perdreau, 1-3 bd du Maréchal-Joffre, Ouvre une nouvelle fenêtre (vers 1895) en sont des exemples remarquables. Sur le plan stylistique, l'éclectisme est largement illustré à Angers, avec une prédilection pour les XVIe et XVIIe siècles au détriment du style Louis XV.
Maisons et immeubles de rapport procèdent du même savoir académique, ainsi la maison néo-Louis XIII d'Adrien Dubos, 95-97 rue du Quinconce, Ouvre une nouvelle fenêtre (1897) ou les immeubles de rapport haussmanniens sur le bd du Maréchal-Foch, Ouvre une nouvelle fenêtre (8 et 8bis), de François Moirin et d'Auguste Beignet (1881 et 1895). L'ouvre la plus originale de cette période est une villa en campagne, 40 rue de la Chambre-aux-Deniers, Ouvre une nouvelle fenêtre, par Louis Duvêtre (1859), d'une composition savante avec superposition de formes convexe et concave, salon en avancée et loggia en creux.
Vers 1900
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont en France une période de plus grande inventivité. La production angevine se ressent de ce nouveau climat, particulièrement dans les quartiers aisés au sud-est du centre-ville : ainsi, des quatre maisons 50-56 avenue Jeanne-d'Arc, Ouvre une nouvelle fenêtre, réunies dans une structure monumentale avec ailes et pavillons à la manière d'un château Renaissance (François Moirin, 1892-1894). Au n° 3-7 de cette même avenue, Ouvre une nouvelle fenêtre, l'hôtel triple d'Hervé Grasset pour le grand manufacturier Julien Bessonneau (1912) procède du même effet ostentatoire avec sa lucarne « Grand siècle ».
Plus étonnante est la maison-atelier de l'architecte René Goblot par sa référence à la Renaissance alsacienne, 39 rue du Quinconce, Ouvre une nouvelle fenêtre (1905). L'historicisme s'avère désormais plus recherché, comme l'illustre aussi une oeuvre de Joseph Ruault, 30 rue Barra, Ouvre une nouvelle fenêtre : cette maison « à l'italienne » avec sa tour-belvédère est un exemple tardif, en 1909, d'un type qui connut un succès international.
Autour de l'Art nouveau
Les deux hôtels associés que Maurice Bernier construit en 1902, 2-4 rue Bougère, Ouvre une nouvelle fenêtre, composent un mélange pittoresque de formes à priori antagonistes, classiques et néo-gothiques, significatif de la plus grande liberté architecturale qui règne au tournant du siècle. Cet ensemble, sans pouvoir être qualifié d'Art nouveau, en dénote l'influence.
Un petit nombre d'habitations appartient à cette mouvance, de manière plus ou moins explicite : la maison conçue par l'entrepreneur Victor Vasselet, 71 rue des Ponts-de-Cé, Ouvre une nouvelle fenêtre (1907), avec sa belle fenêtre en forme de nénuphar, celle d'Henri Palausi, 14 rue de Létanduère, Ouvre une nouvelle fenêtre (1910) ou encore la maison-atelier de l'entrepreneur Auguste Pichon, 19-21 boulevard Carnot, Ouvre une nouvelle fenêtre (1913). Sur cette dernière, l'interpénétration d'ornements empruntés à l'Art nouveau et de motifs classiques et rocaille illustre le baroque 1900. Le meilleur exemple à Angers est donné par l'hôtel Clémot, 36 avenue Jeanne-d'Arc, Ouvre une nouvelle fenêtre, de l'architecte Auguste Martin (1902).